 Les textes sont analogues aux restes diurnes qui servent de prétextes à la formation du rêve. Eux servent de pré-textes à l’émergence de notre propre savoir inconscient.
Les textes sont analogues aux restes diurnes qui servent de prétextes à la formation du rêve. Eux servent de pré-textes à l’émergence de notre propre savoir inconscient.
Lacan a très bien exprimé ce qu’il en est de la puissance du verbe freudien. On y trouve à l’oeuvre ce qu’il en est du désir de Freud et il ne peut que susciter le nôtre. Il a également suscité le désir de Lacan, il n’a jamais abandonné ses solides références à Freud, même dans ses plus tardives élaborations notamment avec celles du noeud borroméen, par exemple il met en relation les trois ronds du symbolique, de l’imaginaire et du réel avec les trois identifications freudiennes, le réel avec l’identification primaire narcissique, le symbolique bien sûr avec l’identification au trait unaire enfin l’imaginaire avec l’identification au désir de l’Autre. On comprend ainsi mieux avec ces trois équivalences ainsi posées que ces trois ronds soient noués par le symptôme puisqu’il participe des trois.
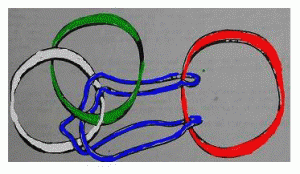
Je cite à nouveau ce passage que j’aime beaucoup sur la valeur de transfert du texte freudien qui se trouve dans sa réponse au commentaire de Jean Hippolite (Ecrits, p. 383)
« J’espère que la reconnaissance que nous éprouvons tous pour la grâce que M. Jean Hyppolite nous a faite de son lumineux exposé pourra justifier à vos yeux, non moins je l’espère qu’aux siens, l’insistance que j’ai mise à l’en prier. Ne voilà-t-il pas, une fois de plus, démontré qu’à proposer à l’esprit le moins prévenu, s’il n’est pas certes le moins exercé, le texte de Freud que je dirai de l’intérêt le plus local en apparence, nous y trouvons cette richesse jamais épuisée de significations qui l’offre par destination à la discipline du commentaire. Non pas un de ces textes à deux dimensions, infiniment plat, comme disent les mathématiciens, qui n’ont de valeur que fiduciaire dans un discours constitué, mais un texte véhicule d’une parole, en tant qu’elle constitue une émergence nouvelle de la vérité. S’il convient d’appliquer à cette sorte de texte toutes les ressources de notre exégèse, ce n’est pas seulement, vous en avez ici l’exemple, pour l’interroger sur ses rapports à celui qui en est l’auteur, mode de critique historique ou littéraire dont la valeur de « résistance » doit sauter aux yeux d’un psychanalyste formé, mais bien pour le faire répondre aux questions qu’il nous pose à nous, le traiter comme une parole véritable, nous devrions dire, si nous connaissions nos propres termes, dans sa valeur de transfert.
Bien entendu, ceci suppose qu’on l’interprète. Y a-t-il, en effet, meilleure méthode critique que celle qui applique à la compréhension d’un message les principes mêmes de compréhension dont il se fait le véhicule ? C’est le mode le plus rationnel d’éprouver son authenticité.
La parole pleine, en effet, se définit par son identité à ce dont elle parle. Et ce texte de Freud nous en fournit un lumineux exemple en confirmant notre thèse du caractère trans-psychologique du champ psychanalytique, comme M. Jean Hyppolite vient de vous le dire en propres termes. C’est pourquoi les textes de Freud se trouvent en fin de compte avoir une véritable valeur formatrice pour le psychanalyste, en le rompant, comme il doit l’être, nous l’enseignons expressément, à l’exercice d’un registre hors duquel son expérience n’est plus rien. Car il ne s’agit de rien de moins que de son adéquation au niveau de l’homme où il s’en saisit, quoi qu’il en pense – auquel il est appelé à lui répondre, quoi qu’il veuille – et dont il assume, quoi qu’il en ait, la responsabilité. C’est dire qu’il n’est pas libre de s’y dérober par un recours hypocrite à sa qualification médicale et une référence indéterminée aux assises de la clinique. »
Les textes de Freud ont donc une valeur formatrice pour le psychanalyste mais de cette lecture il n’est pas libre de s’y dérober au nom de son savoir médical ou de ces dons de clinicien. C’est une question d’éthique, d’éthique de la psychanalyse et d’éthique du psychanalyste. Mais c’est aussi une question logique : si la psychanalyse ne peut être que réinventée par chaque psychanalyste, cette réinvention ne peut que se référer, à chaque fois, à l’invention première dont elle est la répétition.