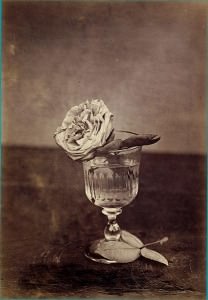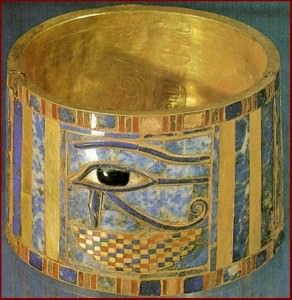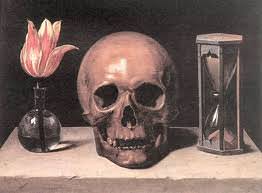Dans le séminaire d’Un discours qui ne serait pas du semblant Lacan prend appui sur le graphe du désir pour rappeler que l’écrit n’est jamais premier mais second par rapport à la parole et que donc ce graphe ne peut pas être abordé d’emblée mais repris pas à pas dans le fil de sa parole tout au long de ses années de séminaire. Ce n’est en effet que par rapport à cette parole qu’on peut donner sens à l’ensemble de ces trajets et surtout à toute la série de petites lettres qui sont incrites à leurs points de croisement. Par contre, une fois construit pas à pas, c’est alors qu’il peut prendre son efficace en interrrogeant de façon renouvelée ce qu’il en est de la clinique analytique car il en constitue l’assise logique.
« L’écrit n’est pas premier mais second par rapport au langage »
Il le dit et le répète : « C’est de la parole bien sûr que se fraie la voie vers l’écrit. Mes Ecrits, si je les ai intitulés comme ça, c’est qu’ils représentent une tentative, une tentative d’écrit, comme c’est suffisamment marqué par ceci que ça aboutit à des graphes. L’ennui, c’est que, c’est que les gens qui prétendent me commenter partent tout de suite des graphes. Ils ont tort, les graphes ne sont compréhensibles qu’en fonction, je dirai, du moindre effet de style des dits Ecrits, qui en sont en quelque sorte les marches d’accès. Moyennant quoi l’écrit, l’écrit repris à soi tout seul, qu’il s’agisse de tel ou tel schéma, celui qu’on appelle L ou n’importe quoi, ou du grand graphe lui-même, présente l’occasion de toutes sortes de malentendus. C’est d’une parole qu’il s’agit, en tant bien sûr et pourquoi, qu’elle tend à frayer la voie à ces graphes qu’il s’agit, mais il convient de ne pas oublier cette parole, pour la raison qu’elle est celle même qui se réfléchit de la règle analytique qui est comme vous le savez: parlez, parlez, pariez [?], il suffit que vous paroliez, voilà la boîte d’où sortent tous les dons du langage, c’est une boîte de Pandore ».
 Au moment où, dans son séminaire « Les structures freudiennes des psychoses » en 1956 , Lacan analyse le grand délire de Schreber en mettant l’accent sur ses deux sortes de troubles du langage, il évoque pour les décrire les travaux de Saussure sur le signifiant et le signifié et surtout les rapports que ce signifiant et ce signifié peuvent avoir entre eux.
Au moment où, dans son séminaire « Les structures freudiennes des psychoses » en 1956 , Lacan analyse le grand délire de Schreber en mettant l’accent sur ses deux sortes de troubles du langage, il évoque pour les décrire les travaux de Saussure sur le signifiant et le signifié et surtout les rapports que ce signifiant et ce signifié peuvent avoir entre eux. Au moment où, dans son séminaire « Les structures freudiennes des psychoses » en 1956 , Lacan analyse le grand délire de Schreber en mettant l’accent sur ses deux sortes de troubles du langage, il évoque pour les décrire les travaux de Saussure sur le signifiant et le signifié et surtout les rapports que ce signifiant et ce signifié peuvent avoir entre eux.
Au moment où, dans son séminaire « Les structures freudiennes des psychoses » en 1956 , Lacan analyse le grand délire de Schreber en mettant l’accent sur ses deux sortes de troubles du langage, il évoque pour les décrire les travaux de Saussure sur le signifiant et le signifié et surtout les rapports que ce signifiant et ce signifié peuvent avoir entre eux.