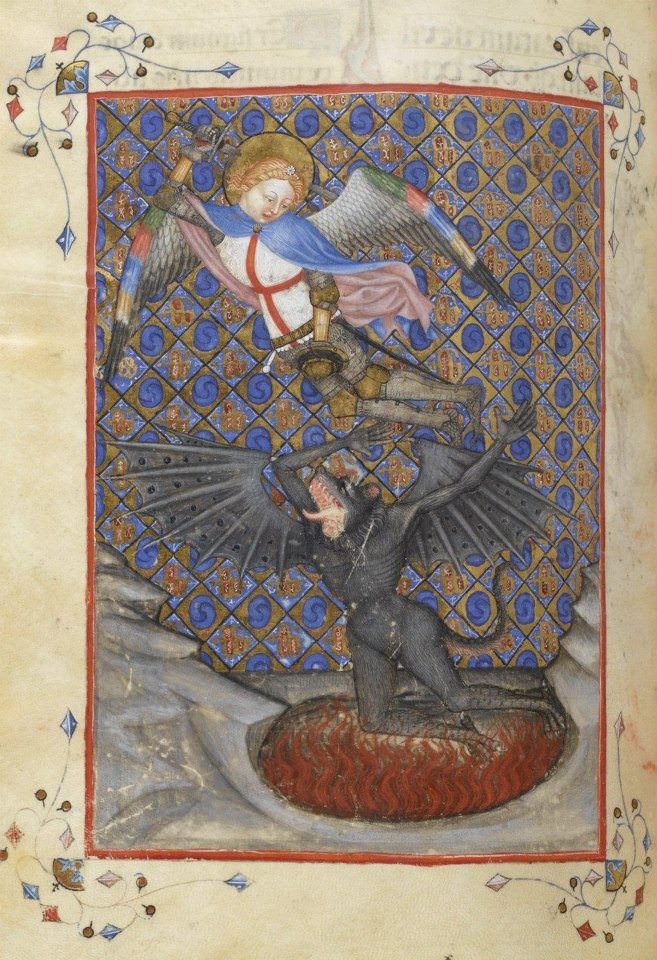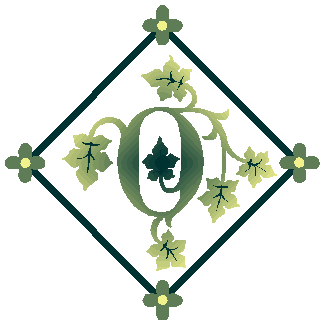Voici un petit topo pour savoir où nous en sommes de cette lecture (supplément à l’histoire d’une névrose infantile) . Nous abordons le chapitre V intitulé : « Le diagnostic » c’est là que va être abordée par l’analyste la question de la psychose de l’Homme aux loups, de sa « paranoïa à forme hypocondriaque ». Les termes utilisés par elle ne sont pas des termes analytiques mais des termes psychiatriques, termes qui au demeurant ne semble jamais avoir été utilisés par Freud (mais c’est à vérifier).
Les amants de Vérone
Comme Lacan s’est beaucoup intéressé aux amours impossibles d’Hamlet et Ophélie, j’ai eu envie de les comparer aux amours tout aussi impossibles de Roméo et de Juliette, dans l’espoir d’y découvrir quelque chose d’intéressant du point de vue des héroïnes féminines. Ophélie en effet d’abord aimée par Hamlet est ensuite rejetée par lui par une sorte d’horreur du féminin qui a été provoquée par la découverte de la jouissance sexuelle de sa mère. Elle ne retrouvera son statut d’objet aimé qu’une fois mise au tombeau et en référence à un objet rival, Laerte. Entre temps elle est devenue folle.
Les amours de Roméo et Juliette quoique impossibles du fait de l’inimitié des deux familles, restent indéfectibles.
« A la céleste idole de mon âme… » La lettre d’amour d’Hamlet à Ophélie
Les rapports d’Hamlet avec Ophélie sont très complexes et évoluent suivant plusieurs temps dramatiques.
Avant la scène III de l’acte I, celle où son père et son frère interdisent à Ophélie d’accepter les hommages d’Hamlet, on est sûr que les deux jeunes gens sont amoureux l’un de l’autre. Après cet interdit posé par le père, Hamlet lui adresse cette lettre d’adieu.
Ainsi on s’aperçoit qu’avant même sa rencontre avec le fantôme de son père, Ophélie est déjà devenue un objet perdu, un objet de deuil.
Le graphe du désir d’Hamlet après la scène du cimetière
Voici comment Lacan décrit l’objet a en tant qu’élément du fantasme 
» Ce que je puis articuler plus avant à propos de cet $ et pour autant qu’il nous intéresse non pas en tant qu’il est confronté, mis en rapport avec la Demande mais avec cet élément que nous allons essayer cette année de serrer de plus près, qui est représenté par la a, le a, objet essentiel objet autour de quoi tourne comme telle, la dialectique du désir, objet autour de quoi le sujet s’éprouve dans une altérité imaginaire […] Et c’est pas cet autre qui est l’objet du désir qu’est remplie une fonction qui définit le désir dans une double coordonnée qui fait qu’il ne vise pas, pas du tout, un objet en tant que tel de satisfaction du besoin, mais un objet en tant qu’il est déjà lui-même relativé, je veux dire mise en relation avec le sujet qui est présent dans le fantasme […] et la fonction de l’objet qui est objet du désir uniquement en ceci qu’il est terme du fantasme, l’objet prend la place de ce dont le sujet est privé symboliquement […] disons que c’est pour autant que dans l’articulation du fantasme, l’objet prend la place de ce dont le sujet est privé, c’est quoi, c’est du phallus que l’objet prend cette fonction qu’il a dans le fantasme et que le désir avec le fantasme pour support se constitue. » Le désir et son interprétation. séance du 15 avril 1959.
« Du haut d’un gratte-ciel » avec l’analyste
Si on repart du rêve des icônes brisées, puis de celui du beau paysage de la scène primitive, si beau qu’il pourrait le peindre – montrant ainsi une possibilité de sublimation, celle la peinture, Ruth indique que dans la réalité il n’a pas encore franchi ces étapes qui étaient décrites dans les rêves. Suit donc un autre rêve mais qui ne semble pas avoir été rapporté textuellement. Je crois que c’est plutôt le récit qu’en fait Ruth M.B. Je trouve qu’il est en grande partie, en tant que tel, indéchiffrable : « le jour suivant il rapport un rêve dans lequel il est couché à ma pieds, ce qui est un retour à la passivité ». Est-ce comme un chien, un chien de berger, un loup ? Puis, en apparence lié à cette phrase, à la suite, elle indique : « il se trouve avec moi dans un gratte-ciel, il n’y a pas d’autre issue qu’une fenêtre (voir le rêve des loups primitif et aussi le rêve ci-dessus) de cette fenêtre une échelle descend vertigineusement jusqu’au sol. Pour sortir il lui faut passer par cette fenêtre. C’est à dire qu’il ne peut pas rester dedans, regardant dehors comme dans l’autre rêve, mais il doit surmonter sa peur et sortir. Il s’éveille en proie à une grande angoisse et cherchant désespérément une autre issue.
Le rêve dit du chaperon (l’analysant d’Ella Sharpe)
Dans cette séance du 14 Janvier 1959 du désir et de son interprétation, Lacan commence par énoncer quelques remarques concernant le rêve et notamment celle-ci qui va lui permettre d’introduire le rêve de l’analysant d’Ella Sharpe, le fait, par exemple, que tous les commentaires qui accompagnent le rêve, qui se produisent en marge de son récit, font déjà partie de son contenu latent. Ils nous mènent sur la voie de son interprétation : « Ce qui en somme est dit par le sujet en note marginale concernant le texte du rêve, à savoir tous les accents de tonalité, ce qui dans une musique s’accompagnent d’annotations comme allegro, crescendo, decrescendo, tout cela fait partie du texte du rêve […] C’est là quelque chose de vraiment fondamental pour ce qui est de l’interprétation d’un rêve […] Il interprète le rêve en intégrant le sentiment de doute par exemple qu’il y a dans ce rêve au moment où le sujet le raconte, comme un des éléments du rêve sans lequel le rêve ne saurait être interprété ». Lacan l’appelle « le colophon du doute » qui est une sorte de marque-page, une petite main l’index pointé qui était utilisée pour indiquer le passage intéressant d’un manuscrit. Ce colophon du doute indique là où se trouve le désir du rêve, ce qu’il y a à chercher.
Fantasme, symptôme et Idéal du moi sur le graphe du désir
J’ai repensé ce matin à cette question du fantasme et à ce qu’il devient au cours de l’analyse. il y a un texte qui me sert toujours de référence et que je trouve absolument magnifique pour sa grand rigueur logique, c’est le texte de Freud « Les fantasmes hystériques dans leur rapport à la bisexualité ». Ces fantasmes sont toujours des fantasmes inconscients et on ne peut les retrouver qu’une fois les symptômes interprétés. Cela c’est le premier point. Mais d’autre part ces symptômes participent à la formation de l’Idéal du moi à la sortie de l’œdipe. Exemple c’est en toussant comme son père que Dora s’identifie à lui (ce faisant ce n’est pas à sa mère qu’elle s’identifie)
Le deuil du phallus au moment du « déclin de l’Œdipe »
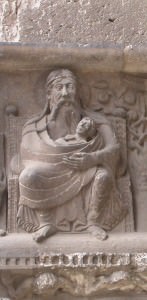 Je cherchais comment reprendre cette série de rêves de castration tels que les organise ensemble Ruth Mack Brunswick (pages 290 à 294) et je suis tombée sur une séance du séminaire le désir et son interprétation qui peut nous servir de nouvelle grille, séance du 29 avril 1959 : Il s’agit de ce que Lacan appelle « deuil de l’objet » qui est deuil du phallus et qui marque en tant que tel ce qui est nommé par Freud « déclin de l’Œdipe » ou encore sa sortie.
Je cherchais comment reprendre cette série de rêves de castration tels que les organise ensemble Ruth Mack Brunswick (pages 290 à 294) et je suis tombée sur une séance du séminaire le désir et son interprétation qui peut nous servir de nouvelle grille, séance du 29 avril 1959 : Il s’agit de ce que Lacan appelle « deuil de l’objet » qui est deuil du phallus et qui marque en tant que tel ce qui est nommé par Freud « déclin de l’Œdipe » ou encore sa sortie.
Rêves de castration et une nouvelle édition, une réactualisation, du rêve des loups dans son analyse avec Ruth
 Sur trois ou quatre pages, pages 290 à 294, Ruth Mack Brunswick rapporte toute une série de rêves décisifs pour cette analyse. Ils s’enchaînent les uns avec les autres et il devient difficile d’en rendre compte en raison de l’abondance du matériel. Je tente d’abord de les présenter ensemble avec la façon dont ils s’articulent l’un par rapport à l’autre et je les reprendrais ensuite un par un.
Sur trois ou quatre pages, pages 290 à 294, Ruth Mack Brunswick rapporte toute une série de rêves décisifs pour cette analyse. Ils s’enchaînent les uns avec les autres et il devient difficile d’en rendre compte en raison de l’abondance du matériel. Je tente d’abord de les présenter ensemble avec la façon dont ils s’articulent l’un par rapport à l’autre et je les reprendrais ensuite un par un.
Les trois rêves après le coup de massue de Ruth
Nous en sommes pages 290 et 291 du gardiner, dans le chapitre « le cours de l’analyse actuelle ». Ruth l’avoue en toute sérénité « … ma technique consista à détruire par tous les moyens cette idée du patient qu’il fut le fils préféré de Freud, car il était évident que grâce à cette idée il se mettait à l’abri de sentiments d’un toute autre nature. Je lui fis toucher du doigt sa position réelle par rapport à Freud et l’absence totale (ce que je savais par Freud lui-même être la vérité) de tous rapports sociaux et personnels entre eux. »