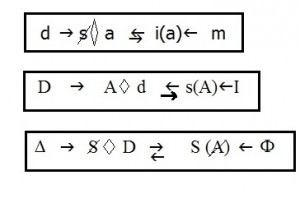Les signifiants de la pulsion et ses liens avec l’objet a A propos des signifiants de la pulsion et de leurs liens avec l’objet a, dans l’occurrence, avec l’objet oral, une courte observation clinique de Ferenczi peut en apporter la preuve. Elle démontre qu’il vaut mieux ne pas ouvrir le corsage d’une femme pour espérer y retrouver l’objet pourtant à jamais perdu. Il rapporte en effet l’histoire d’un jeune médecin qui chaque fois qu’il devait ausculter une femme et qu’il approchait donc son oreille de sa poitrine se mettait à saliver. Il en avait l’eau à la bouche1 : « Un étudiant qui finit sa médecine me raconte qu’à chaque fois qu’il va ausculter une femme et dans ce but approche sa tête de la poitrine de celle-ci, il es pris d’un brusque afflux de salive ; en général sa sécrétion salivaire ne dépasse pas la normale. Je n’ai aucun doute sur l’origine…
« Un certain savoir sur la psychose »
 J’ai eu la chance mais aussi l’honneur d’être l’amie de Jacy Arditi. C’est un honneur car elle était exigeante aussi bien par rapport à son travail que par rapport au choix de ses amis. Elle avait une grande rigueur aussi bien morale qu’intellectuelle. Elle était cultivée et grâce à elle j’ai découvert beaucoup de livres que je ne connaissais pas.Quand elle trouvait que ce que j’avais écrit était bien, je pouvais m’y fier, quand elle le critiquait, c’était justifié, j’en tenais le plus grand compte. Le plus souvent à la fin de mon texte, elle s’écriait « « c’est tout ! Tu ne vas quand même pas t’arrêter là ! ». Le lendemain je me remettais courageusement à l’ouvrage sous son impulsion. Tous ceux qui s’essaient à l’écriture le savent, le savoir inconscient qui demande pourtant à s’exprimer, se montre cependant rebelle, récalcitrant. Il faut le forcer, le débusquer. Jacy m’y encourageait.
J’ai eu la chance mais aussi l’honneur d’être l’amie de Jacy Arditi. C’est un honneur car elle était exigeante aussi bien par rapport à son travail que par rapport au choix de ses amis. Elle avait une grande rigueur aussi bien morale qu’intellectuelle. Elle était cultivée et grâce à elle j’ai découvert beaucoup de livres que je ne connaissais pas.Quand elle trouvait que ce que j’avais écrit était bien, je pouvais m’y fier, quand elle le critiquait, c’était justifié, j’en tenais le plus grand compte. Le plus souvent à la fin de mon texte, elle s’écriait « « c’est tout ! Tu ne vas quand même pas t’arrêter là ! ». Le lendemain je me remettais courageusement à l’ouvrage sous son impulsion. Tous ceux qui s’essaient à l’écriture le savent, le savoir inconscient qui demande pourtant à s’exprimer, se montre cependant rebelle, récalcitrant. Il faut le forcer, le débusquer. Jacy m’y encourageait.
Du cheval à la voiture ou le travail de Freud avec le signifiant
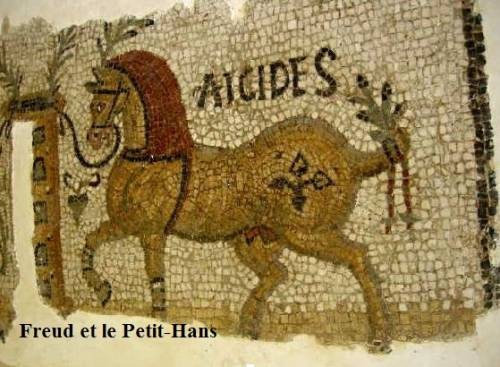 La page 133 des cinq psychanalyses est consacrée à l’équivoque que permet la langue allemande entre « wegen » et « wagen », le premier pouvant être traduit « à cause de » et le second étant « voiture »au pluriel. C’est à cause des voitures que le Petit Hans dit avoir attrapé la bêtise. En fait c’est à cause de cette équivoque signifiante qu’il y a eu une extension de la phobie du cheval aux voitures à chevaux.
La page 133 des cinq psychanalyses est consacrée à l’équivoque que permet la langue allemande entre « wegen » et « wagen », le premier pouvant être traduit « à cause de » et le second étant « voiture »au pluriel. C’est à cause des voitures que le Petit Hans dit avoir attrapé la bêtise. En fait c’est à cause de cette équivoque signifiante qu’il y a eu une extension de la phobie du cheval aux voitures à chevaux.
9 – Les « petits mythes » du Petit-Hans
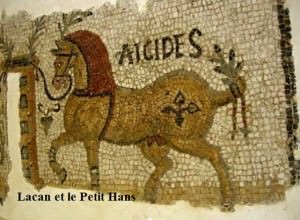 Lacan commence sa lecture de la cinquième des cinq psychanalyses, celle du Petit Hans, dans le séminaire de la relation d’objet. A titre de points de repères, il évoque le fantasme de la girafe chiffonnée dans la séance du 27 février 1957, puis la fonction du père réel du Petit Hans en tant qu’agent de la castration symbolique dans la séance du 6 mars 1957. Il y prend appui sur son tableau des trois registres de la privation, frustration, castration, surtout dans la séance du 13 mars 1957.Ce qu’il précise bien en prenant appui sur le cas du Petit Hans, c’est « le caractère fondamental du lien qu’il y a entre le père réel et la castration ». Autrement dit avec l’aide concrète de l’analyse du Petit Hans il tente de faire saisir ce qu’est la castration symbolique du sujet.
Lacan commence sa lecture de la cinquième des cinq psychanalyses, celle du Petit Hans, dans le séminaire de la relation d’objet. A titre de points de repères, il évoque le fantasme de la girafe chiffonnée dans la séance du 27 février 1957, puis la fonction du père réel du Petit Hans en tant qu’agent de la castration symbolique dans la séance du 6 mars 1957. Il y prend appui sur son tableau des trois registres de la privation, frustration, castration, surtout dans la séance du 13 mars 1957.Ce qu’il précise bien en prenant appui sur le cas du Petit Hans, c’est « le caractère fondamental du lien qu’il y a entre le père réel et la castration ». Autrement dit avec l’aide concrète de l’analyse du Petit Hans il tente de faire saisir ce qu’est la castration symbolique du sujet.
13 – La suite du « programme du Petit-Hans » se déroule autour de l’entrepôt
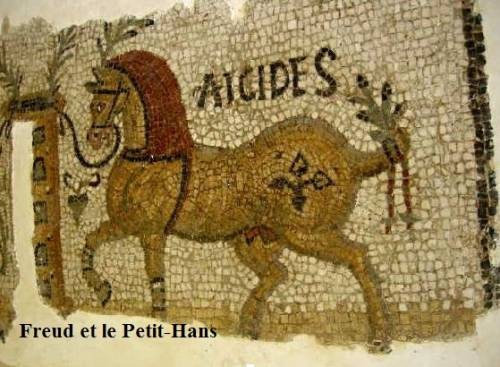 Nous en sommes page 122 du texte du Petit-Hans. Nous avons repéré que Hans a en quelque sorte entériné l’interprétation de Freud. Il reconnaît que son cheval d’angoisse et son père ne font qu’un.
Nous en sommes page 122 du texte du Petit-Hans. Nous avons repéré que Hans a en quelque sorte entériné l’interprétation de Freud. Il reconnaît que son cheval d’angoisse et son père ne font qu’un.
Il le reconnaît en effet par cette plaisanterie « Papa, reste ! Ne t’en va pas au galop ! »
Freud y apporte ce commentaire « Nous savons que cette partie de l’angoisse de Hans a deux composantes : la peur du père et la peur pour le père. La première dérive de son hostilité contre son père, la seconde du conflit de la tendresse – ici exagérée par réaction – avec l’hostilité.
12 – « Papa, reste, ne t’en va pas au galop »
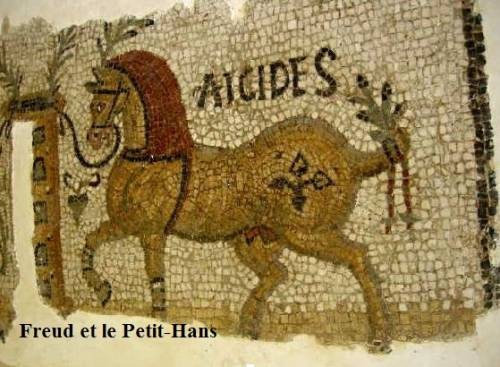 Ce dialogue se développe entre Hans et son père à la suite de l’intervention de Freud, son énonciation : « j’ai toujours su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par suite forcé d’avoir peur de son père, et que je l’avais annoncé à son père ». Tout ce qui est mentionné à cette page 121 des cinq psychanalyses est à considérer comme un effet de cette interprétation de Freud.
Ce dialogue se développe entre Hans et son père à la suite de l’intervention de Freud, son énonciation : « j’ai toujours su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par suite forcé d’avoir peur de son père, et que je l’avais annoncé à son père ». Tout ce qui est mentionné à cette page 121 des cinq psychanalyses est à considérer comme un effet de cette interprétation de Freud.
11 – Les effets de l’interprétation de Freud
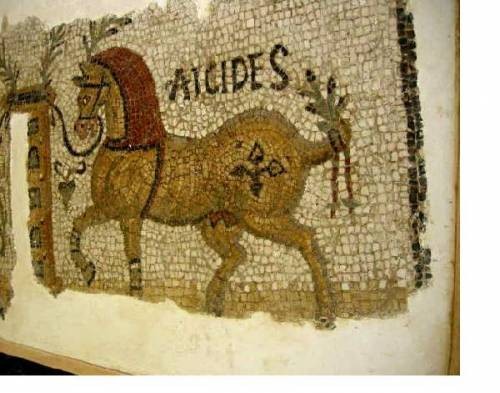 Nous en sommes p. 121 des Cinq psychanalyses. Freud décrit maintenant ce qu’on peut appeler les effets de son interprétation. Au cours de sa rencontre avec le Petit-Hans, Freud lui a en effet dit « Bien avant qu’il ne vint au monde, j’avais déjà su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par la suite forcé de d’avoir peur de son père, et je l’avais annoncé à son père. »
Nous en sommes p. 121 des Cinq psychanalyses. Freud décrit maintenant ce qu’on peut appeler les effets de son interprétation. Au cours de sa rencontre avec le Petit-Hans, Freud lui a en effet dit « Bien avant qu’il ne vint au monde, j’avais déjà su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par la suite forcé de d’avoir peur de son père, et je l’avais annoncé à son père. »
On ne peut qu’admirer l’élégance de cette formulation. Il présente en effet cette interprétation comme une histoire, comme un conte pour enfant. Il joue au magicien ou un devin. L’essentiel porte sur le fait que ce ne sont pas des chevaux dont le Petit Hans a peur mais de son père.
10 – Moustache et monocle du père
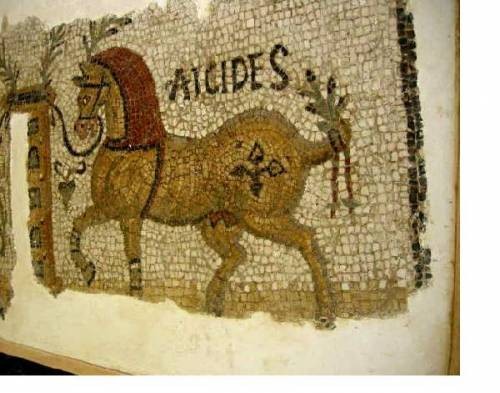
Au bas de la page 119 Freud décrit ce qui s’est passé au cours de sa rencontre avec le Petit-Hans en présence de son père. Nous assistons sans doute ainsi à la première séance d’une analyse d’enfant. On y découvre il me semble le côté primesautier de Freud, sa spontanéité.
« Cet après-midi là, le père et le fils vinrent me voir à ma consultation. Je connaissais déjà le drôle de petit bonhomme et, avec toute son assurance, il était si gentil que j’avais eu chaque fois plaisir à la voir. Je ne sais s’il se souvenait de moi, mais il se comporta de façon irréprochable et comme un membre tout à fait raisonnable de la société humaine. La consultation fut courte. Le père commença par dire que, malgré tous les éclaircissements donnés à Hans, sa peur des chevaux n’avait pas diminué. »
Jouissance clitoridienne et jouissance vaginale

Freud les avait dénommées ainsi : jouissance clitoridienne et jouissance vaginale. Il faudrait les reprendre dans le texte freudien. Je ne sais plus où mais je me souviens qu’au moment où il décrit la façon dont l’une doit céder la place à l’autre, il trouve cette jolie métaphore, il compare la jouissance clitoridienne à la façon dont on doit démarrer un feu de bois à l’aide de petites brindilles, pour pouvoir faire un beau feu de cheminée. C’est la fonction de la jouissance clitoridienne, elle met le feu aux grosses bûches. C’est vrai que, dans le séminaire Encore, Lacan énonce que cette autre jouissance dite vaginale est de l’ordre de la mystique et qu’il essaie de la nommer d’une autre façon, jouissance supplémentaire, jouissance au-delà du phallus ou encore l’autre jouissance, mais il n’empêche qu’il utilise ce terme de jouissance vaginale dans ce chapitre même « Dieu et la jouissance de la femme » (la barré), même si c’est pour le regretter. C’est au bas de la page 69 : « Bien entendu, tout ça dans le discours, hélas, de Freud comme dans l’amour courtois est recouvert pas de menues considérations sur la jouissance clitoridienne et sur la jouissance qu’on appelle comme on peut l’autre justement, celle que je suis entrain d’essayer de vous faire aborder par la voie logique car il n’y en a pas d’autre. Ce qui laisse quelque chance à ce que j’avance, à savoir que de cette jouissance, la femme ne sait rien, c’est que depuis le temps qu’on les supplie […] je parlais la dernière fois des psychanalystes femmes […] on n’a jamais rien pu en tirer. Alors on l’appelle comme on peut cette jouissance, vaginale, on parle pôle postérieur du museau de l’utérus et autres conneries, c’est le cas de le dire ».
Le masque du symptôme, l’Idéal du moi et le Surmoi
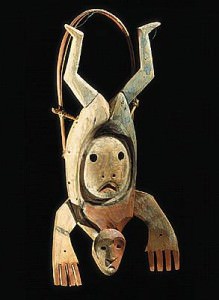 Dans le séminaire des Formations de l’inconscient, séance du 16 avril 1958, Lacan inscrit sur le graphe du désir, les deux formations freudiennes qui ont surgi ensemble dans la théorie freudienne, celles de l’Idéal du moi et du Surmoi.Il les reprend en fonction de ces trois lignes d’écritures qu’il avait inventées les séances précédentes,
Dans le séminaire des Formations de l’inconscient, séance du 16 avril 1958, Lacan inscrit sur le graphe du désir, les deux formations freudiennes qui ont surgi ensemble dans la théorie freudienne, celles de l’Idéal du moi et du Surmoi.Il les reprend en fonction de ces trois lignes d’écritures qu’il avait inventées les séances précédentes,