Je voulais écrire quelque chose sur la poésie de Mallarmé, et en lisant quelques uns de ses textes, j’ai trouvé ce passage amusant : C’est un petit paragraphe à propos d’une question qu’on pose à Mallarmé : « Connaissez-vous les psychologues ? – Un peu. Il me semble qu’après les grandes oeuvres de Flaubert, des Goncourt et de Zola, qui sont des sortes de poèmes, on est revenu aujourd’hui au vieux goût français du siècle dernier, beaucoup plus humble et modeste qui consiste non à prendre à la peinture ses moyens pour montrer la forme extérieure des choses, mais à disséquer les motifs de l’âme humaine. Mais il y a entre cela et la poésie, la même différence qu’il y a entre un corset et une belle gorge… » L’évocation de la métapsychologie, de la « fée métapsychologie », comme corset semble un peu rude et dépourvue en effet de poésie, par…
« Avant-propos » de la première des cinq psychanalyses

Je vois surtout dans cet avant-propos, celui qui introduit la première des cinq psychanalyses, une argumentation nourrie rédigée à l’avance à l’usage de ces futurs détracteurs. Ce qui le laisse penser c’est le peu de succès qu’a eu son livre de l’Interprétation des rêves et le scandale qu’a provoqué quelques années après, ses trois essais sur la théorie de la sexualité.
Il prend en quelque sorte les devants.
Je passe sur l’exposition de ses scrupules ainsi que sur la difficulté d’exposer un cas et ceci sans prendre de notes, pour arriver directement page 3 à cette question de l’interprétation des rêves.
Freud comptait appeler ce texte : « Rêve et hystérie » pour montrer comment » l’interprétation des rêves s’entrelace à l’histoire du traitement « . Et il faut remarquer ce terme » histoire du traitement » il ne s’agit plus de l’histoire de Dora telle qu’elle l’a racontée au départ, mais de ce qui s’est passé dans l’analyse, cela devient l’histoire de Freud et de Dora, peut-on se risquer à dire que c’est l’histoire des démêlés de Freud avec Dora.
Par ailleurs, avez-vous remarqué combien dans ce texte Freud parle souvent de « technique ».
C’est ce terme qui m’a sauté aux yeux en relisant Dora.
Je trouve que ça vaudrait la peine de s’interroger, à partir de ce texte de Freud sur les rapports qui existent et qui ne sont pas souvent abordé entre
certes la clinique et la théorie analytique mais aussi avec la technique, qui est à proprement parler ce qu’on pourrait appeler le métier du psychanalyste, son tour de main, puis plus mystérieux, celui de l’éthique de la psychanalyse.
Exercice de style autour du Réel, symbolique et imaginaire noués par le symptôme
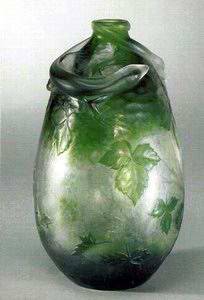
Lacan a introduit très tôt dans son enseignement ces trois catégories du Symbolique, de l’Imaginaire et du Réel comme étant trois catégories qui permettent de structurer ce qu’il en est de l’expérience analytique, de pouvoir s’y repérer de façon rigoureuse et surtout d’assurer ce qui est la fonction décisive du psychanalyste, l’interprétation.
Ce R.S.I en raccourci, est une gageure que nous avait proposée une participante à une liste de discussion consacrée à la psychanalyse : Peut-on dire, juste en quelques mots ce que sont ces trois catégories du Réel, du Symbolique et de l’imaginaire et comment ils sont noués par le symptôme ?
J’ai essayé de le démontrer à l’aide de trois exemples, trois traits d’esprit, ceux que Lacan a empruntés à Freud, et qu’il commente dans le séminaire des Formations de l’inconscient.
Le rêve du miroir incendiaire d’Archimède

Ce rêve, tout comme le rêve de « Rabbi Savonarole », est lui aussi mis tout d’abord en relation avec la périodicité de Fliess, celle des périodes de 28 et de 23 jours qui sont mises en lien respectivement avec la féminité ou la virilité. Cette périodicité Freud la réfute cependant à chaque fois, pour évoquer un événement de la veille qui a provoqué son rêve, en l’occurrence, cette fois-ci, le fait qu’il avait appris une mauvaise nouvelle, la suppression du lieu où il pouvait jusqu’alors donner ses conférences. Cela lui avait sans doute fait penser, écrit-il, à ses débuts de jeune médecin où on lui avait refusé toute aide d’où son appel à Archimède et à ses « miroirs incendiaires ». Lui saurait au moins lui trouver un lieu où parler de psychanalyse.
Le célèbre rêve de la belle bouchère

Le moment est venu de travailler le rêve de la belle bouchère. A vrai dire, comme je l’ai déjà beaucoup travaillé au fil de toutes ces années, j’avais peur d’en être un peu lassée à l’avance, mais avec Freud, les lectures sont toujours nouvelles, j’avais grand tort de le penser. Je l’ai lu et retravaillé avec un très grand plaisir
Ce rêve dit de la Belle Bouchère, figure avec quelques autres, dont le rêve de l’oncle Joseph, dans le chapitre IV de l’Interprétation du rêve, ayant pour titre, « La défiguration du rêve ».
Le rêve dit des services d’amour
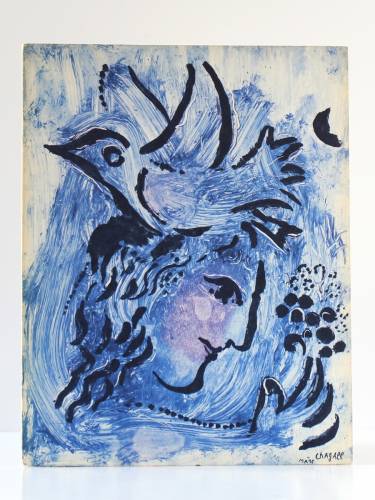 Ce rêve ne figure qu’en note de l’interprétation du rêve1. Il a été rapporté par le docteur Hermine von Hug-Hellmuth et il est cité par Freud pour décrire ce qu’est la fonction de la censure dans la déformation du rêve. Il n’a pas été interprété mais il est malgré tout assez transparent.
Ce rêve ne figure qu’en note de l’interprétation du rêve1. Il a été rapporté par le docteur Hermine von Hug-Hellmuth et il est cité par Freud pour décrire ce qu’est la fonction de la censure dans la déformation du rêve. Il n’a pas été interprété mais il est malgré tout assez transparent.
Celle qui rêve est une femme de cinquante ans, veuve depuis douze ans d’un colonel de l’armée et dont l’un de ses fils est lui aussi dans l’armée.
Freud écrit « Pour effacer les passages qui lui paraissent choquants la défiguration onirique travaille dans cet exemple avec les mêmes moyens que la censure épistolaire. Celle-ci rend ce genre de passages illisibles en les recouvrant d’un large trait d’encre, la censure onirique les remplace par un marmonnement incompréhensible »
Le rêve d’Anna et le rêve d’Hermann
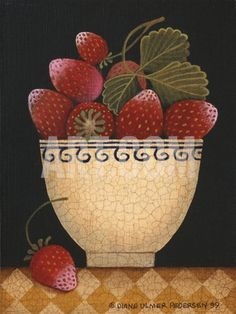 Parmi tous les rêves d’enfants que Freud décrit dans ce chapitre III intitulé « le rêve est une satisfaction de désir », se trouvent deux rêves qui méritent d’être rapprochés l’un de l’autre, surtout si on les inscrit sur les deux chaînes, signifiante et signifiée, du graphe du désir.
Parmi tous les rêves d’enfants que Freud décrit dans ce chapitre III intitulé « le rêve est une satisfaction de désir », se trouvent deux rêves qui méritent d’être rapprochés l’un de l’autre, surtout si on les inscrit sur les deux chaînes, signifiante et signifiée, du graphe du désir.
Rêves de soif
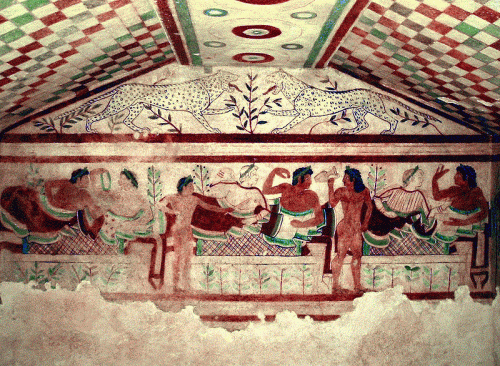 A l’orée de ce nouveau chapitre, chapitre III ayant pour titre « Le rêve est une satisfaction de désir » Freud devient lyrique. Il admire le paysage qui se présente devant lui, prend le temps de choisir les chemins qu’il empruntera, se réjouit surtout de l’exploit accompli. On le sent heureux et il y a de quoi : « Quand au sortir d’un nouveau chemin creux on débouche soudain sur une hauteur où les chemins se divisent et où s’offrent au regard dans des directions différentes les perspectives les plus riches, on a bien le droit de se poser un instant et de se demander de quel côté on va d’abord tourner ses pas. Quelque chose de semblable nous arrive à présent, maintenant que nous avons passé le cap de cette première interprétation d’un rêve. Nous sommes dans la grande clarté d’une révélation soudaine». Arrivé au sommet, Freud admire le panorama qui se présente à lui.
A l’orée de ce nouveau chapitre, chapitre III ayant pour titre « Le rêve est une satisfaction de désir » Freud devient lyrique. Il admire le paysage qui se présente devant lui, prend le temps de choisir les chemins qu’il empruntera, se réjouit surtout de l’exploit accompli. On le sent heureux et il y a de quoi : « Quand au sortir d’un nouveau chemin creux on débouche soudain sur une hauteur où les chemins se divisent et où s’offrent au regard dans des directions différentes les perspectives les plus riches, on a bien le droit de se poser un instant et de se demander de quel côté on va d’abord tourner ses pas. Quelque chose de semblable nous arrive à présent, maintenant que nous avons passé le cap de cette première interprétation d’un rêve. Nous sommes dans la grande clarté d’une révélation soudaine». Arrivé au sommet, Freud admire le panorama qui se présente à lui.
Une vision d’horreur, la gorge d’Irma
 Dans la séance précédente, celle du 9 février 1956, Lacan a commencé à lire ce rêve de l’injection faite à Irma avec l’aide du schéma L. Il inscrit ainsi sur l’axe imaginaire du schéma (du petit autre au moi), toute la première partie de ce rêve où Freud s’identifie avec toute la série des femmes puis des hommes qui ont été invités à discuter avec lui de l’état de santé d’Irma. sur l’axe symbolique (du grand A au S), Il inscrit ce qu’il appelle « sa conversation inconsciente avec Fliess, ce qui correspond donc à son auto-analyse. Nous avons donc là une première vue d’ensemble de la structure de ce rêve.
Dans la séance précédente, celle du 9 février 1956, Lacan a commencé à lire ce rêve de l’injection faite à Irma avec l’aide du schéma L. Il inscrit ainsi sur l’axe imaginaire du schéma (du petit autre au moi), toute la première partie de ce rêve où Freud s’identifie avec toute la série des femmes puis des hommes qui ont été invités à discuter avec lui de l’état de santé d’Irma. sur l’axe symbolique (du grand A au S), Il inscrit ce qu’il appelle « sa conversation inconsciente avec Fliess, ce qui correspond donc à son auto-analyse. Nous avons donc là une première vue d’ensemble de la structure de ce rêve.
Dans cette seconde séance du 9 mars 1956, il indique : « ce rêve nous allons le prendre avec notre point de vue de maintenant » et donc notamment avec la notion du signifiant et surtout avec les trois registres du symbolique, de l’Imaginaire et du Réel.
Lacan relit le rêve de l’injection faite à Irma avec le schéma L

Séance du 9 février 1955
Quand on commence à lire une séance du séminaire on ne sait jamais où elle va nous entraîner. Comme je voulais un peu replacer à nouveau ce rêve de l’injections faite à Irma, tel que Lacan s’y intéresse dans ce séminaire, je me suis aperçue qu’il prend cette question du rêve d’une façon inversée par rapport à celle de Freud.
Je m’explique, Freud commence par présenter matériellement ce qu’est l’interprétation d’un rêve, avec ce rêve de l’injection faite à Irma, avant même d’avancer son schéma de l’appareil psychique dans le chapitre VII du livre.
Lacan prend le chemin inverse, dans cette première séance qu’il consacre à l’analyse de ce rêve, celle du 9 février 1956, il décrit d’abord ce qu’il en est des différents temps d’élaboration de cet appareil de l’Esquisse à la Traumdeutung et s’arrête longuement sur les difficultés qu’a rencontré Freud pour rendre compte de l’état de conscience, ce qu’il appelle le système perception conscience. Il explique par une jolie métaphore, que ces appareils ne sont que les « premiers battements d’ailes de Freud » et que ce qui ne lui permettait pas de résoudre le problème c’est le fait qu’il n’avait pas encore pris en compte la question du narcissisme.