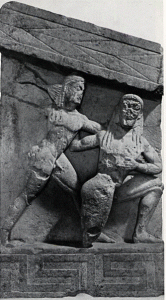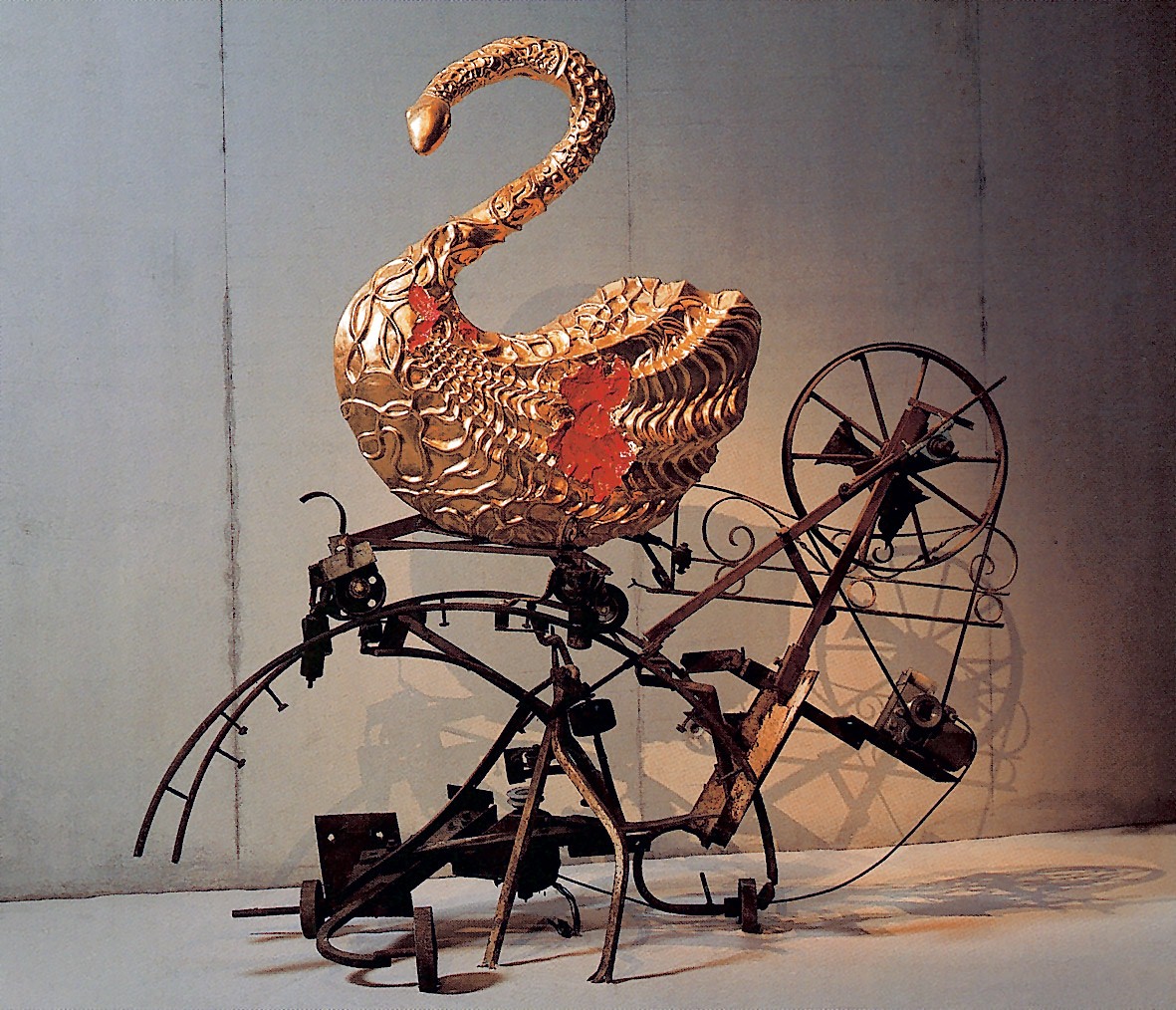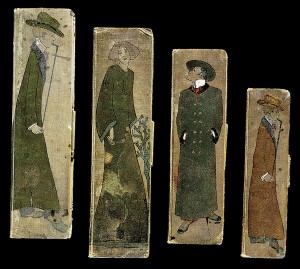 D’entrée de jeu, avant de nous livrer le texte de ce second rêve de Dora (p.69), Freud pose les trois acquis qui ont permis son déchiffrage :
D’entrée de jeu, avant de nous livrer le texte de ce second rêve de Dora (p.69), Freud pose les trois acquis qui ont permis son déchiffrage :
Le désir évanescent de l’obsessionnel
Délire dans la névrose et dans la psychose
 Il est utile de rappeler qu’il y a une radicale différence de structure entre la névrose et la psychose sans oublier bien sûr celle de la perversion.
Il est utile de rappeler qu’il y a une radicale différence de structure entre la névrose et la psychose sans oublier bien sûr celle de la perversion.
L’absurdité dans les rêves et les obsessions
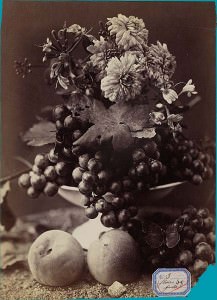 La question de l’absurdité apparente des obsessions est abordée par Freud dans sa grande étude de la névrose obsessionnelle avec l’histoire de l’Homme aux rats.
La question de l’absurdité apparente des obsessions est abordée par Freud dans sa grande étude de la névrose obsessionnelle avec l’histoire de l’Homme aux rats.
Dès les premières phrases de ce paragraphe du texte qui a pour titre « Quelques obsessions et leur explication » , Freud nous explique que tout comme pour le rêve il ne faut pas se laisser impressionner par l’apparente absurdité et incohérence de ces obsessions : « On fait bien de ne jamais se laisser troubler, dans cette tâche de la traduction des obsessions, par leur apparente absurdité ; les obsessions les plus absurdes et les plus étranges se laissent résoudre si on les approfondit dûment. »
C’était un jour de grandes manœuvres
Le phallus sur le graphe du désir
 Cette séance des formations de l’inconscient du 14 mai 1957 est d’une très grande richesse mais très complexe.
Cette séance des formations de l’inconscient du 14 mai 1957 est d’une très grande richesse mais très complexe.
J’ai essayé pour moi-même d’en établir un plan et donc d’en saisir une vue d’ensemble.
Masochisme dit féminin… et complexe de castration masculin
Un extrait de mon livre ‘Lettres à Nathanaël ; Une invitation à la psychanalyse »
 Cher Nathanaël, j’aborde avec toi, aujourd’hui, une question bien difficile celle du masochisme dit féminin des hommes, masochisme qui mystérieusement les féminise, ce qui provoque l’horreur et le rejet de ces mécanismes qui sont donc de fait violemment refoulés. Seule l’analyse peut le remettre à jour mais non sans mal.
Cher Nathanaël, j’aborde avec toi, aujourd’hui, une question bien difficile celle du masochisme dit féminin des hommes, masochisme qui mystérieusement les féminise, ce qui provoque l’horreur et le rejet de ces mécanismes qui sont donc de fait violemment refoulés. Seule l’analyse peut le remettre à jour mais non sans mal.
A propos de la situation familiale de Renée (2)
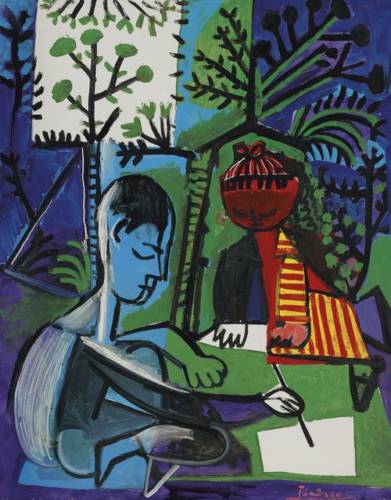
Ce qui frappe dans l’exposé que nous en fait Bouvet, c’est la sorte de maîtrise qu’il en a, comme si rien ne lui avait échappé, ni de son Œdipe normal, haine pour la mère et amour pour le père, ni de son Œdipe inversé, avec fixation intense à la mère et haine pour le père en tant qu’il est son objet rival dans cet amour.
Au cœur de l’expérience analytique, le mythe d’Œdipe
 Au cœur de l’expérience analytique, se trouve le mythe d’Œdipe, mythe qu’il convient de reprendre, de compléter à partir de l’expérience que nous en avons. Ce texte « Le mythe individuel du névrosé » date de 1953. Il sera intéressant de le mettre en correspondance avec l’un des séminaires plus tardifs, celui d’un discours qui ne serait pas du semblant où il s’attaque résolument à ces deux mythes de l’Œdipe et de Totem et tabou, pour nous proposer d’y substituer une logique de l’écrit.
Au cœur de l’expérience analytique, se trouve le mythe d’Œdipe, mythe qu’il convient de reprendre, de compléter à partir de l’expérience que nous en avons. Ce texte « Le mythe individuel du névrosé » date de 1953. Il sera intéressant de le mettre en correspondance avec l’un des séminaires plus tardifs, celui d’un discours qui ne serait pas du semblant où il s’attaque résolument à ces deux mythes de l’Œdipe et de Totem et tabou, pour nous proposer d’y substituer une logique de l’écrit.