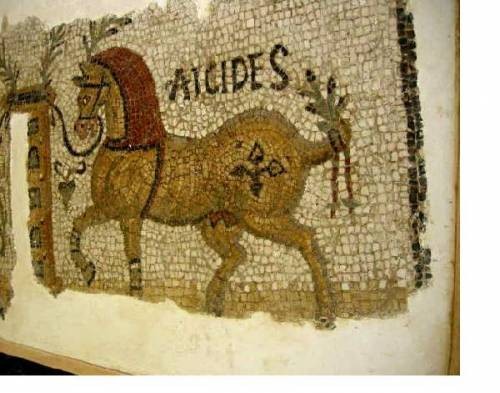
Mon impression était juste : l’apparition de la phobie du Petit Hans, sa peur d’être mordu par un cheval, vient en second après l’étude attentive voire intrusive que fait le père de sa sexualité infantile et surtout de sa curiosité sexuelle à propos du « Fait-pipi ». Il a fait de son propre enfant un objet d’études, un objet qu’il partage avec Freud.
Première apparition de ce que Freud nomme complexe de castration dans les « Trois essais sur la théorie de la sexualité »
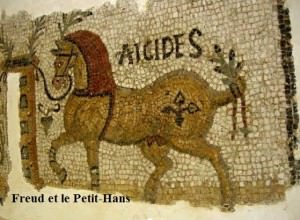 Chacune des cinq psychanalyses a à trouver place dans l’ensemble de l’oeuvre freudienne. Ainsi l’analyse de Dora devait avoir primitivement pour titre « Rêve et hystérie » et se trouvait être un complément à « L’interprétation des rêves ». De même l’analyse du Petit Hans, comme Freud nous l’annonce, prend la suite des « Trois essais sur la théorie de la sexualité ». Ces derniers datent de 1905 et le Petit Hans de 1909.
Chacune des cinq psychanalyses a à trouver place dans l’ensemble de l’oeuvre freudienne. Ainsi l’analyse de Dora devait avoir primitivement pour titre « Rêve et hystérie » et se trouvait être un complément à « L’interprétation des rêves ». De même l’analyse du Petit Hans, comme Freud nous l’annonce, prend la suite des « Trois essais sur la théorie de la sexualité ». Ces derniers datent de 1905 et le Petit Hans de 1909.
Les trois pères dans la traversée de l’Œdipe
 Nous pouvons déjà repérer dans ces séances consacrées à la métaphore paternelle ‘dans le séminaire des Formations de l’inconscient, que Lacan explore toutes les questions que soulève l’Œdipe, celle bien sûr de la névrose, avec au coeur de celle-ci, les difficultés théoriques et cliniques que pose l’Œdipe dit inversé, celui où le sujet, le garçon, souhaite être aimé de son père comme une femme, dans une position féminine passive. Il évoque aussi la question des perturbations qui se produisent dans le champ de la réalité perturbations qui sont communes, quoique de façon différente, à la perversion et à la psychose.
Nous pouvons déjà repérer dans ces séances consacrées à la métaphore paternelle ‘dans le séminaire des Formations de l’inconscient, que Lacan explore toutes les questions que soulève l’Œdipe, celle bien sûr de la névrose, avec au coeur de celle-ci, les difficultés théoriques et cliniques que pose l’Œdipe dit inversé, celui où le sujet, le garçon, souhaite être aimé de son père comme une femme, dans une position féminine passive. Il évoque aussi la question des perturbations qui se produisent dans le champ de la réalité perturbations qui sont communes, quoique de façon différente, à la perversion et à la psychose.
« La névrose a pour issue la destruction du complexe d’Œdipe »
 Je livre à votre méditation ce passage d’inhibition, symptôme et angoisse, à la fin du chapitre VI : « Etudier la formation de symptôme, dans d’autres affections que les phobies, l’hystérie de conversion et la névrose obsessionnelle, serait infructueux, car nous en savons trop peu à leur sujet. Mais l’examen critique et comparé de ces trois névroses fait apparaître un problème d’importance et qui ne saurait plus être ajourné. Chacune de ces trois névroses a pour issue la destruction du complexe d’Œdipe et nous admettons que dans toutes les trois l’angoisse de castration est ce qui conduit le moi à se dresser contre le processus pulsionnel du (moi) ». Ici, c’est un lapsus sans doute du traducteur. Bien sûr il faut lire « le processus pulsionnel du ça ».
Je livre à votre méditation ce passage d’inhibition, symptôme et angoisse, à la fin du chapitre VI : « Etudier la formation de symptôme, dans d’autres affections que les phobies, l’hystérie de conversion et la névrose obsessionnelle, serait infructueux, car nous en savons trop peu à leur sujet. Mais l’examen critique et comparé de ces trois névroses fait apparaître un problème d’importance et qui ne saurait plus être ajourné. Chacune de ces trois névroses a pour issue la destruction du complexe d’Œdipe et nous admettons que dans toutes les trois l’angoisse de castration est ce qui conduit le moi à se dresser contre le processus pulsionnel du (moi) ». Ici, c’est un lapsus sans doute du traducteur. Bien sûr il faut lire « le processus pulsionnel du ça ».
Donc, premier point, nous sommes en 1925 et pourtant Freud déclare en quelque sorte forfait quant à son approche des deux autres structures, psychose et perversion, alors qu’il a pourtant déjà écrit son texte sur le Président Schreber mais n’a pas trouvé le mécanisme spécifique qui détermine le phénomène psychotique.
Mais le second point important est celui de la « destruction » du complexe d’Œdipe comme issue de la névrose.
Du « Gain de plaisir » de Freud au « Plus-de-jouir » de Lacan
 Dans la seconde séance des non dupes errent Lacan se réfère à un texte de Freud qui n’est pas facile à trouver. Son titre exact est « Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation des rêves », ajout qui date de 1925. Lacan s’y intéresse à ce qu’il nomme « les limites de l’interprétation ».
Dans la seconde séance des non dupes errent Lacan se réfère à un texte de Freud qui n’est pas facile à trouver. Son titre exact est « Quelques additifs à l’ensemble de l’interprétation des rêves », ajout qui date de 1925. Lacan s’y intéresse à ce qu’il nomme « les limites de l’interprétation ».
Au cours de cette séance des non dupes errent, il parle en effet de la mathématique freudienne et on peut mesurer que ce qu’il pose comme strictement équivalent à sa mathématique à lui, sa mathématique analytique, c’est la stricte équivalence entre ce que Freud appelle « gain de plaisir » et, lui, « Plus de jouir ». Or ce que Freud définit comme ce gain de plaisir c’est ce qu’apporte le rêve en permettant au désir inconscient de se manifester comme retour du refoulé. Dans le rêve tout est permis… ou presque.
les origines pulsionnelles de nos plus hautes performances intellectuelles
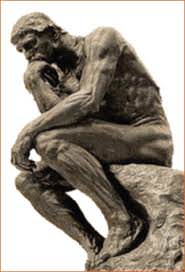 L’isolation, un des mécanismes de fabrication du symptôme
L’isolation, un des mécanismes de fabrication du symptôme
Après l’annulation rétroactive, dans ce chapitre VI d’inhibition, symptôme et Angoisse, Freud décrit ce qu’il appelle le mécanisme de l’isolation. Il rattache ce mécanisme d’une part à la concentration intellectuelle, d’autre part au tabou du toucher. Comme pour le premier mécanisme décrit, celui de l’annulation rétrospective, Freud décrit d’une part ce qui relève de la structure de la névrose et d’autre part de la « normalité ».
L’annulation rétroactive et la compulsion de répétition
 Dans ma version d’inhibition, symptôme et angoisse, celle du PUF, couverture marron, la page 42 est à la fois magistrale et terriblement difficile, ce qui est surprenant dans ce passage c’est qu’il rapproche l’un des mécanismes typiques des modes de refoulement de la névrose obsessionnelle, ce qu’il appelle « annulation rétroactive » de la « compulsion de répétition ».
Dans ma version d’inhibition, symptôme et angoisse, celle du PUF, couverture marron, la page 42 est à la fois magistrale et terriblement difficile, ce qui est surprenant dans ce passage c’est qu’il rapproche l’un des mécanismes typiques des modes de refoulement de la névrose obsessionnelle, ce qu’il appelle « annulation rétroactive » de la « compulsion de répétition ».
« Il n’y a d’analyse que du particulier »
 On éprouve le besoin d’aérer un peu ce texte d’Inhibition, symptôme et angoisse, en repartant en effet d’exemples cliniques, car il relève d’une sorte de mathématisation de la théorie freudienne. C’est ce que Freud lui-même a fait en reprenant, pour les comparer l’analyse de la phobie de l’Homme aux loups et celle du Petit Hans
On éprouve le besoin d’aérer un peu ce texte d’Inhibition, symptôme et angoisse, en repartant en effet d’exemples cliniques, car il relève d’une sorte de mathématisation de la théorie freudienne. C’est ce que Freud lui-même a fait en reprenant, pour les comparer l’analyse de la phobie de l’Homme aux loups et celle du Petit Hans
Un rêve de Freud, le rêve dit du W.C. de campagne
Liliane Fainsilber
 C’est l’un de mes rêves préférés. Freud le raconte et l’interprète dans son livre l’Interprétation des rêves. On peut tout d’abord y mesurer le courage qu’il lui a fallu pour transgresser ainsi tous les tabous de la société viennoise de son époque, tabous, non seulement sexuels mais excrémentiels, et ce, en y décrivant ses propres rêves. Mais on y mesure également son humour et sa fantaisie : « Hercule, c’est moi ! » dit-il.
C’est l’un de mes rêves préférés. Freud le raconte et l’interprète dans son livre l’Interprétation des rêves. On peut tout d’abord y mesurer le courage qu’il lui a fallu pour transgresser ainsi tous les tabous de la société viennoise de son époque, tabous, non seulement sexuels mais excrémentiels, et ce, en y décrivant ses propres rêves. Mais on y mesure également son humour et sa fantaisie : « Hercule, c’est moi ! » dit-il.
Une hallucination hystérique, celle de Lucy, une des héroïnes des Etudes sur l’hystérie

En ce début de chapitre V d’Inhibition, symptôme et angoisse, Freud évoque tout d’abord la question des symptômes hystériques et notamment la question de ce qu’est la « conversion hystérique », comment ils deviennent symptômes corporels :