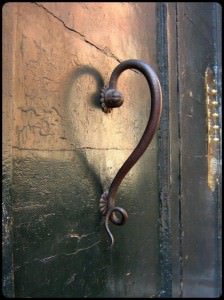Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre.
Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre.
Il trouve place dans ce chapitre que Freud consacre au symbolisme, mais justement pour y apporter une sorte de restriction, de limite, de ses pouvoirs dans l’interprétation des rêves. Il rappelle que
l’essentiel est en effet de prendre appui sur les associations du rêveur et que le symbolisme n’en est qu’un adjuvant qui ne vient en quelque sorte que conforter ce qu’on peut déduire quant au déchiffrage de ce rêve à partir de ces associations.
“ Mais je voudrais ici aussi mettre en garde expressément contre la surestimation de la signification des symboles pour l’interprétation du rêve, contre la réduction par exemple du travail de traduction du
rêve à une traduction de symboles et contre l’abandon de la technique d’exploitation des idées qui viennent à l’esprit du rêveur. Les deux techniques doivent se compléter l’une l’autre. Mais sur le plan
pratique aussi bien théorique la priorité demeure au procédé initialement décrit, qui attribue aux propos exprimés par le rêveur la signification décisive, tandis que la traduction des symboles à
laquelle nous nous livrons vient s’ajouter comme une ressource auxiliaire.”
Voici le texte de ce beau petit rêve :
“ Je me promène en été dans la rue, je porte un chapeau de paille d’une forme particulière, dont la partie médiane est recourbée vers le haut, et dont les côtés pendant vers le bas ( la description se bloquant ici un instant) et de telle manière qu’une partie latérale se trouve plus basse que l’autre. Je suis joyeuse et d’humeur confiante, et au moment où je passe devant une troupe de jeunes officiers, je pense à part moi : vous tous, vous ne pouvez rien me faire du tout”.
 Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.”
Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.” Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre.
Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre. 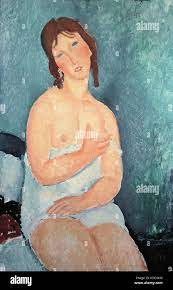
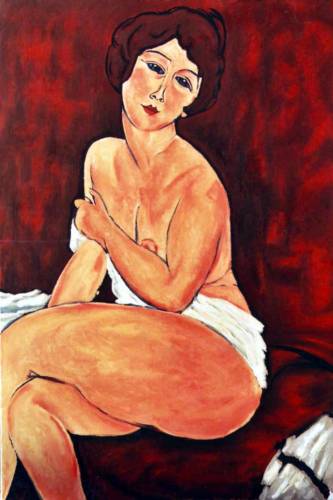
 Nous travaillons toujours pas à pas, ce chapitre intitulé « le travail du rêve ». Nous en sommes à la page 372 et 373, où Freud nous présente deux rêves, l’un étant très précis, très net, l’autre, flou et confus.
Nous travaillons toujours pas à pas, ce chapitre intitulé « le travail du rêve ». Nous en sommes à la page 372 et 373, où Freud nous présente deux rêves, l’un étant très précis, très net, l’autre, flou et confus.